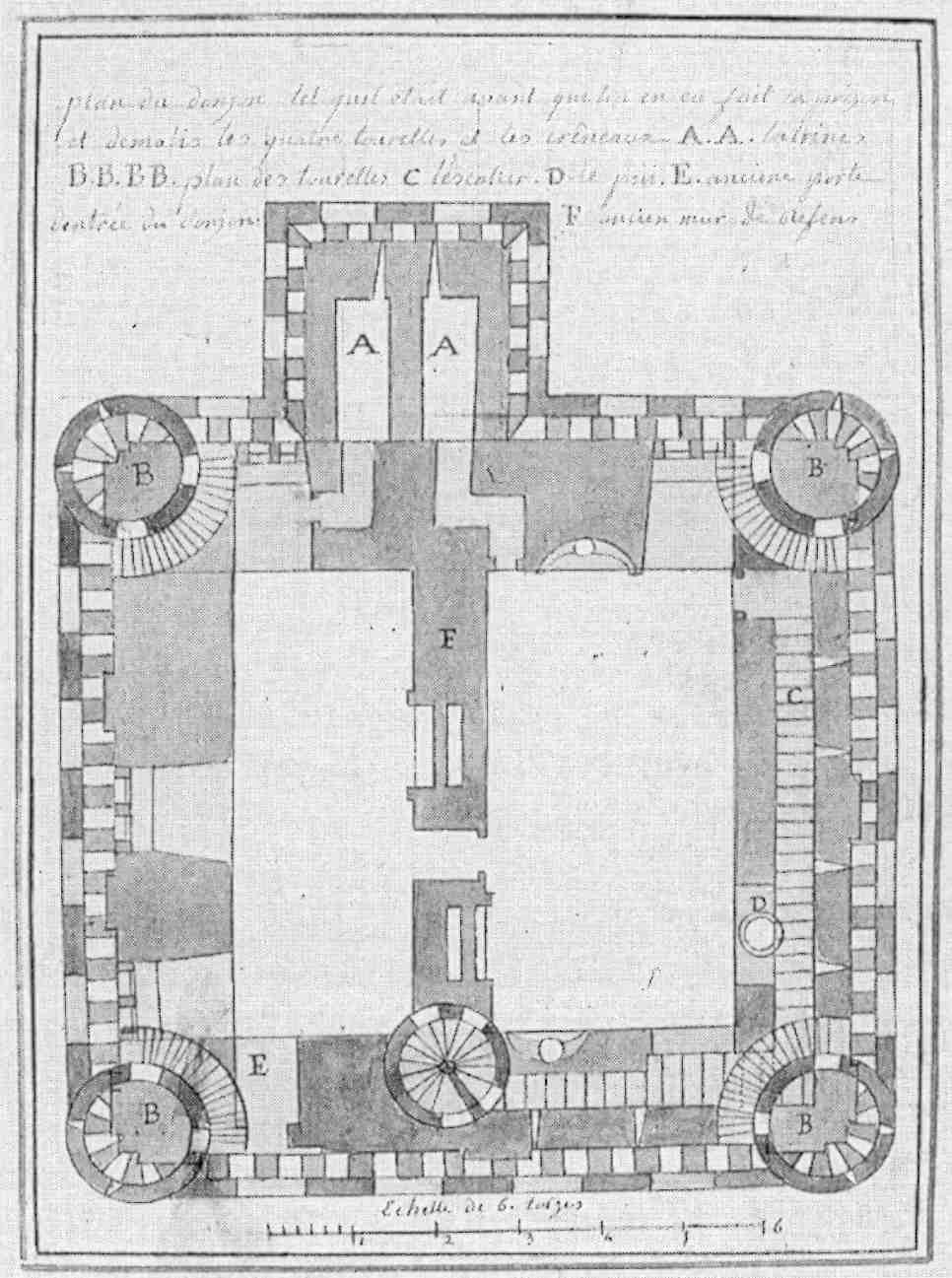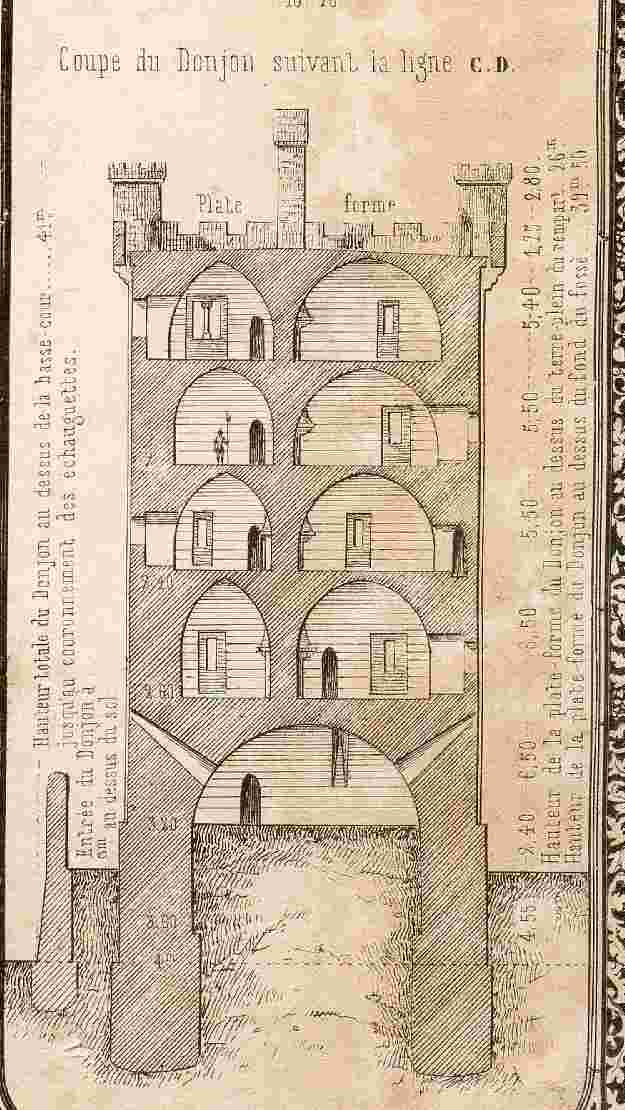vue 25
La fonction de chaque étage dans un donjon rectangulaire
Le donjon rectangulaire comprend
généralement "trois ou quatre niveaux et une plate-forme
sommitale. Le rez-de-chaussée est toujours aveugle pour des raisons
de sécurité ; il sert de magasin pour entreposer des armes,
des vivres (silos à grain, à viande et à poisson séché),
un trésor éventuellement. Il sert rarement de prison.
L'accès à ce niveau de base
se fait par une échelle ou un escalier à partir du premier
étage.
Au premier étage, on trouve la
résidence princière ou seigneuriale composée d'une
salle, et, séparées par le mur de refend percé de
portes ou d'arcades, des chambres, celle du maître, celle des filles
et des nourrissons.
Au deuxième et au troisième
étages, la chambre des garçons et des locaux réservés
à la garnison.
La circulation intermédiaire se
fait par des escaliers droits compris dans l'épaisseur des murs.
La plate-forme sommitale est constituée
par le sommet des murs et par la surface des toits en très faible
pente. Le chemin de ronde est protégé par le crénelage...
Un puits assure l'approvisionnement en
eau : il est le plus souvent placé dans l'épaisseur du mur
de refend de façon à desservir facilement tous les étages
y compris la plate-forme...
L'entrée se situe toujours au premier
étage pour des raisons de sécurité. On accède
à la porte soit par une passerelle de bois amovible (un tronçon
formant pont-levis et porte), soit par un avant-corps en pierre contenant
un escalier droit." ( Decaens J., 1997, p. 185-186).
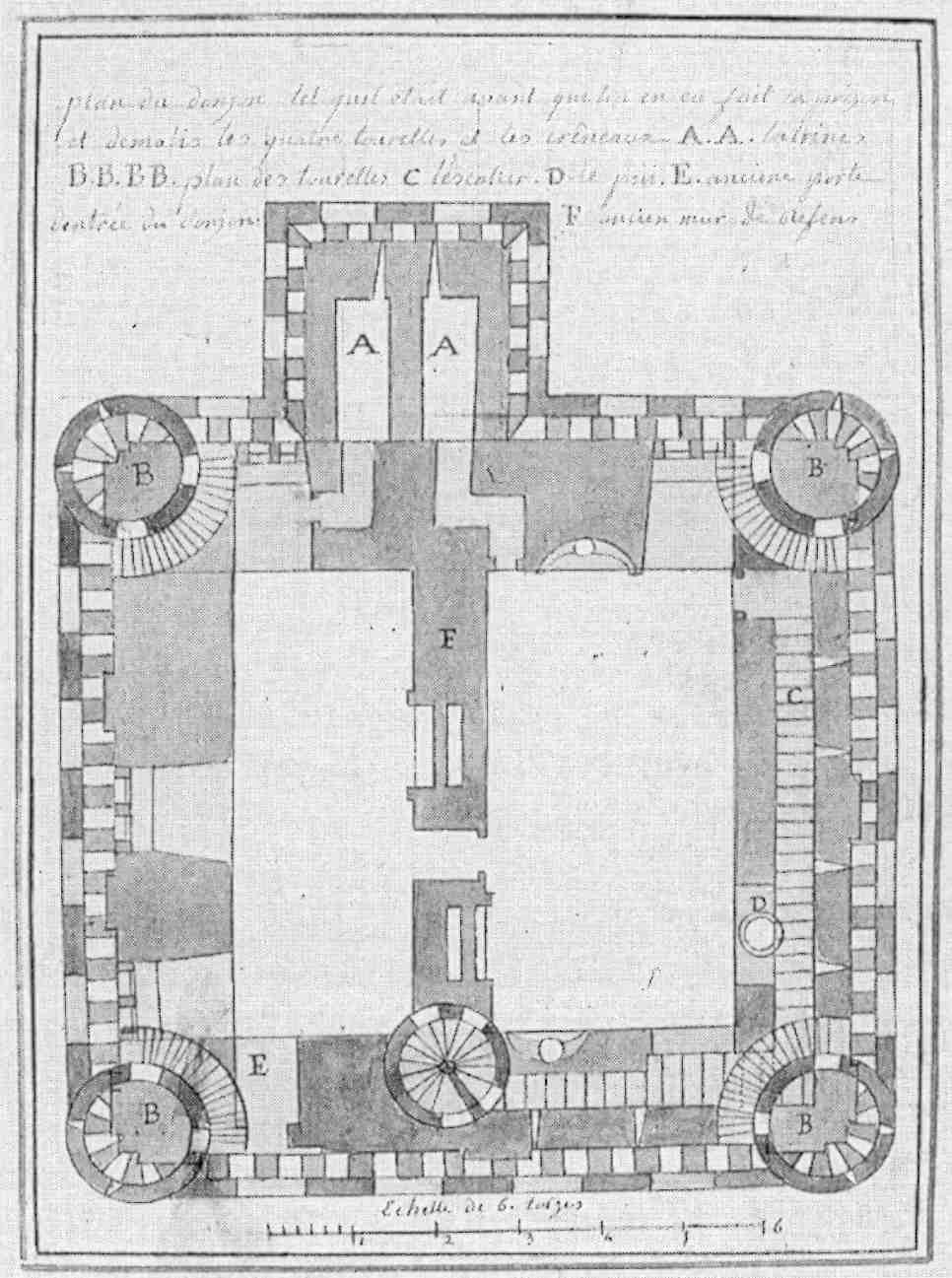 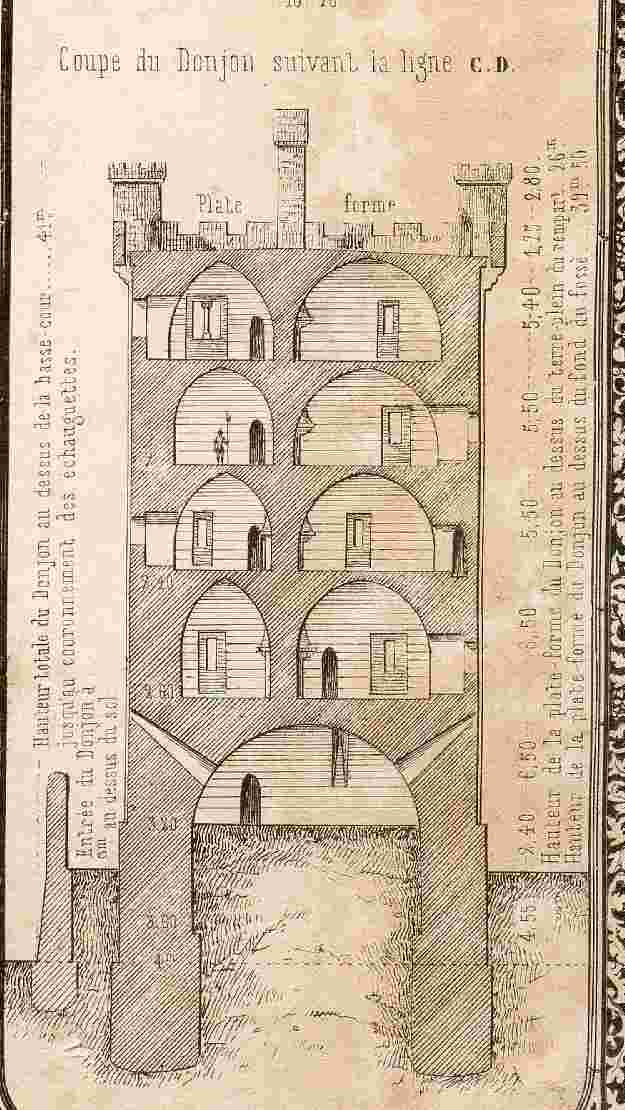
fig. 5 - Le Queu (à gauche) ; fig 30 (à droite)
: reconstitution de L. Hedin montrant
des voûtes à chaque étage alors qu'il n'y en avait
qu'au premier niveau.
|
Ce que l'on sait pour Alençon
Au XIIème siècle,
le donjon d'Alençon et sa chemise devaient être les seuls
édifices bien construits du château, le reste pouvait être
en bois. La tour était alors à la fois le siège du
pouvoir exécutif et judiciaire et le logement du seigneur. Les salles
du rez de chaussée (à 13 m de haut) cumulaient selon les
heures toutes les fonctions.
L’édifice médiéval
du XV ème siècle comportait six niveaux : niveau de fondation,
voûté en plein cintre, puis rez de chaussée, dont l’entrée
devait se trouver au niveau du fronton du palais de justice actuel, et
quatre étages, tous couverts d’un plancher, reposant à chaque
niveau sur un mur de refends qui accueillait les foyers et les conduits
des cheminées (I. Chave, 1998, p110).
Le donjon abritait encore
sous l’occupation anglaise un certain nombre de chambres, comme celle d’un
lieutenant, sans doute du vicomte ou du capitaine (A.N. KK 1338, n°
96. 1439, 22 nov.) ; et un espace de convivialité, la salle du danjon.
Les certificat du maître des œuvres, pour des travaux d’installation
de gouttières et de tuiles, ou de charpente, en 1438 et 1439, la
situent manifestement au dernier niveau.
La salle disposait des installations
de confort de l’édifice : un four, propre au donjon, mentionné
en 1439 (A.N., KK 1338, n° 96. 1439, 22 nov.); un puits, représenté
sur le plan géométral de Le Queu (repère D). Sa localisation,
au rez-de-chaussée, sous la rampe de l’escalier inframural, est
confirmée par les plans du rez-de-chaussée et des trois premiers
étages du donjon, donnés par l’ingénieur Boesnier,
en décembre 1780. Le dernier étage est celui des deux grandes
baies à meneau, mais aussi de deux bassins ménagés
dans les murs sud-ouest et nord-est, absents des plans des étages
inférieurs par Boesnier (I. Chave, 1998, p. 127).
La grande salle dans les
châteaux (ou aula)
(Au XII ème siècle
elle était souvent au rez de chaussée du donjon, par la suite
elle a souvent été déplacée dans la haute cour)
"La grande salle est, par
excellence, le coeur de la vie du château ou du palais. Au pignon
est installée l'estrade, et, au centre de celle-ci, le dais sous
lequel trône le maître des lieux, encadré par épouse
et dames d'honneur. A proximité est installé le dressoir
portant avec ostentation les signes du train de vie seigneurial. Le long
des murs de la grande salle sont disposés quelques bancs; mais on
marche plus qu'on est assis. C'est ici que se déroulent les fêtes
et les grands événements, les repas officiels, mais aussi
la justice.
Les pouvoirs exécutifs
et judiciaires exigent, de tout temps, des espaces publics pour s'exprimer
et s'exhiber [...] devant un public soigneusement choisi pour reconnaître
le pouvoir. [...] Dès l'origine de la féodalité, il
exista dans le château une salle commune où le seigneur prenait
ses repas, où il exerçait sa justice, rassemblait ses conseillers
afin qu'ils délibèrent. Lorsque le moment du repas s'achevait,
les tables étaient démontées, on dressait éventuellement
les sièges pour la justice seigneuriale ; le soir, une fois le souper
terminé, on remplaçait les tréteaux par des lits destinés
aux hôtes de passage les plus marquants [...] dans une promiscuité
aujourd'hui oubliée ; le ménestrel avait chanté sa
chanson, avant que les paillasses dressées par le service ne reçoivent
les corps de chevaliers exténués par chasses et tournois.
Le décor des espaces
résidentiels était, en lui même, signe de richesse,
de luxe et d'ostentation. On oublie trop souvent aujourd'hui que, dans
la plupart des salles, les murs portaient des peintures sur enduits figurant
des scènes de tournoi, de guerre ou de chasse, voire simplement
des des décors de fausses tentures. Les plafonds contribuaient à
cette mise en scène."
(J. Mesqui, 1995, p. 80-85)
|
|

 vue 56
vue 56